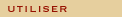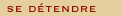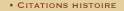| La
plaie béante de Ground Zero renvoie à
la brèche profonde, ouverte dans la capacité
de l’Etat américain à assurer
la sécurité de ses citoyens. Par
son irruption violente et la mort de citoyens,
le terrorisme rompt le pacte de sécurité
établi entre l’Etat et ses habitants
et ébranle la légitimité
de la puissance publique. Intenable politiquement,
cette flagrante fragilité a mis les dirigeants
américains au défi de répondre
de façon satisfaisante et de retrouver
la crédibilité perdue. En proclamant
d’emblée leur soutien total aux Etats-Unis,
les responsables politiques français ont
élargi ce défi à l’Etat
et à la classe politique nationale. Cette
solidarité, fondée sur une communauté
de valeurs fondamentales, étend l’attaque
aux structures politiques nationales, garantes
de ces valeurs. En outre, les menaces globales
des terroristes font de chaque pays occidental
une cible potentielle. Face à une telle
atteinte au système politique, ses représentants
se devaient de gérer cette fracture afin
de la circonscrire. Mais, face au terrorisme,
la réponse ne peut qu’être
policière et/ou militaire. La lutte anti-terroriste
est longue et incertaine, en outre, elle est conduite
par des services qui travaillent dans l’ombre.
Une lutte
symbolique à trois composantes
Les pouvoirs
publics doivent donc travailler sur les perceptions
de la réalité, en attendant d’éventuels
succès concrets (comme le démantèlement
d’un réseau terroriste ou la condamnation
pénale d’auteurs d’attentats),
en diffusant des schémas d’interprétations
adéquats. L’objectif est ici de
réduire le désarroi de la population
et le discrédit de l’Etat affaibli
en proposant des lectures appropriées
de l’événement. Nous verrons
pourquoi le lien entre les médias et
la classe dirigeante est alors décisif.
Avec son caractère intrinsèquement
symbolique, la réponse au terrorisme
laisse une place capitale au discours. «
Le discours et l’art de présenter
la réalité d’une politique
publique sont primordiaux. Tout État,
en particulier démocratique, est un acteur
social qui doit composer avec des acteurs sociaux
concurrentiels pacifiques, les groupes d’intérêt,
voire violents, par exemple les groupes terroristes,
et avec des électeurs qu’il doit
convaincre. Aussi, sauf à se lancer dans
une quête impossible, les stratégies
de communication en ces domaines, pour être
efficaces, visent donc le plus souvent la simplicité.
Elles offrent avant tout, en ce sens, une information
de représentation et au moins pour ce
motif, elles sont un élément fondamental
de la politique publique anti-terroriste. Cette
recherche de la simplification s’apparente
à la recherche de l’efficacité.
» (1).
La nature de l’acte
terroriste vient renforcer cet état de
fait. L’écho médiatique
est un élément structurant de
l’action terroriste. Si une définition
unique et reconnue est une véritable
gageure (142 définitions différentes
sont recensées par l’ONU), la dimension
symbolique demeure un trait fondamental. Ainsi,
la définition juridique française,
issue de l’article 421-1 du nouveau Code
pénal, intègre les notions d’opinion
publique et de peur.
« Constituent des actes de terrorisme,
lorsqu’elles sont “intentionnellement”
en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement
l’ordre public par l’intimidation
ou la terreur (…) » (2).
L’acte terroriste intègre donc
la diffusion de son acte afin d’être
efficace. « Tel est bien,
en effet, le terrorisme : une arme au service
d’un but, ou, plus exactement, une technique
de combat agissant comme une procédure
d’influence dans la perspective de subvertir
le pouvoir en place et d’accaparer psychologiquement
les populations. »
(3) . Le terrorisme peut même
être considéré comme un
acte de communication dévoyée.
Le minutage de la seconde attaque contre les
tours du World Trade Center afin que celle-ci
soit suivie en direct par les télévisions
corrobore cette affirmation classique de l’analyse
terroriste. L’acte terroriste s’imprime
autant dans les faits que dans les têtes
et nécessite de facto une régulation
discursive, « d’où
le besoin de débusquer une réalité
qui ne se livre pas vraiment, de l’objectiver
pour pouvoir mieux la connaître, de lui
donner un statut de catégorie de façon
à limiter la dimension psychologique
inquiétante qu’engendre la notion
de menace. » (4).
En tant qu’acte de violence politique,
l’attentat doit apparaître comme
légitime d’où le fait que
cette action comporte une dimension symbolique.
La violence terroriste
est difficilement appréhendée
par les régimes politiques dans lesquels
nous vivons et ce, pour trois raisons majeures.
Une société démocratique
tente d’évacuer la violence politique
tandis que les terroristes la réintroduisent
de manière soudaine. L’acte terroriste
vient bousculer le calendrier politique traditionnel
et nécessite une capacité d’adaptation
importante de la part des personnes au pouvoir.
Enfin, il bouscule notre représentation
du monde, il réinterroge des fondements
de notre mémoire sociale, ce patrimoine
symbolique qui structure les références
de notre quotidien. La réponse proposée,
les justifications publiques activées
en seront d’autant plus décisives
et montreront les valeurs fondamentales en fonction
desquelles les régimes démocratiques
se construisent. Les discours politiques comme
médiatiques créent un ensemble
de récits régulateurs qui doivent
néanmoins s’ancrer dans une culture
politique et un passé reconnus. Cette
gestion discursive renvoie à une représentation
du monde qui fait sens pour les acteurs : celle
d’une attaque contre « nos »
valeurs et « nos » sociétés.
Ce processus de légitimation a pour objectif
in fine d’obtenir le consensus de la population.
C’est précisément
à travers cet objectif de régulation
que nous nous intéresserons aux rapports
entre médias et dirigeants politiques.
L’action de l’Etat passe par le
rétablissement d’un consensus social
qui vient d’être altéré
par la violence. Pour recourir à la force,
la puissance publique ne peut pas se passer
de ce consensus sous peine de tomber dans une
gestion autoritaire. En tant que médiateurs
entre la puissance étatique et la population,
les journalistes relayent les tentatives politiques
de gestion et jouent un rôle déterminant
dans la perception de l’événement
et de ses conséquences par la population.
« La presse assure une fonction
de cohésion sociale face au terrorisme. »
(5) . L’efficacité
d’une réponse au terrorisme ne
réside donc pas essentiellement dans
la qualité de ses services anti-terroristes
mais également dans une communication
appropriée et perceptible. Les pratiques
anciennes de contrôle (censure, interdiction)
n’ayant qu’une efficacité
limitée en démocratie, la gestion
étatique doit s'organiser d’une
autre manière, notamment par le contrôle
de la dimension symbolique. « L’Etat
cherche à occuper le terrain du discours
public en devenant “la source” privilégiée
des médias, en émettant un discours
tellement prégnant que les médias
peuvent difficilement échapper à
sa terminologie. » (6).
L’Etat tente donc d’imprégner
un discours idoine dont l’objectif est
la reprise multiple par les médias. Ainsi,
d’une médiatisation traditionnellement
pensée à deux entre les médias
et les terroristes, nous passons à un
jeu à trois en intégrant le pouvoir
d’Etat. Dans le cadre d’un attentat,
cette gestion de la violence par la mise en
récit revêt une importance équivalente,
vis-à-vis des citoyens, à la lutte
effective des services anti-terroristes. Face
aux attentats du 11 septembre 2001, la nécessité
médiatique de fictionnarisation a rencontré
la volonté étatique d’organiser
une réponse adéquate à
opposer aux terroristes.
Afin de donner
un bref aperçu de ces processus régulateurs,
nous allons nous intéresser à
la lecture du 11-Septembre par deux journaux
français, Le Monde et Libération,
importants prescripteurs d’opinions dans
le paysage médiatique. Nous nous intéresserons
aux éditions parues les deux jours suivants
les attentats de New York et Washington. Nous
intégrerons également les réactions
des dirigeants politiques français le
jour des attentats pour tenter d’établir
un lien entre les lectures médiatiques
et politiques de l’événement.
Une des particularités de l’attentat
est l’absence de revendication (7),
au moins durant le mois de septembre, du troisième
acteur du triptyque évoqué précédemment,
les terroristes. En effet, les attentats de
New York et Washington semblent d’une
telle lisibilité qu’ils n’ont
pas besoin d’une revendication, l’attentat
constituant un acte de communication en soi.
Cette absence, momentanée, prive les
acteurs du jeu terroriste d’un des participants
et obligent les deux restants, médias
et classe politique, à interpréter
et à construire le discours et les intentions
terroristes. Notre hypothèse se concentre
sur le fait que les représentants politiques
et médiatiques cherchent, par une lecture
particulière des attentats du 11 septembre
2001, à gérer la perception de
cet événement. Les registres sémantiques
constituent ainsi des modes de justification
publique dont l’objectif est de réguler
la représentation sociale de cette violence
inédite.
Le récit
impossible : images et paroles d’acteurs
Le premier
élément qui frappe l’observateur
est la présence récurrente des
photographies pour représenter l’attentat.
Libération va même innover
en mettant sur la une et sur la dernière
page la même photo dans la continuité.
Cette image des tours du World Trade Center
en flammes comporte seulement la date de la
veille et le nom du journal. Comme si cet événement
ne pouvait être nommé autrement
que par un élément temporel brut,
sans valeur ajoutée interprétative
(ce qui s’avérera être pertinent
plus tard à mesure que la dénomination
usuelle de ces attentats deviendra le 11-Septembre).
Au Monde, même le traditionnel
dessin de Plantu a laissé la place à
une photo de Manhattan enfumé. La fréquence
des photographies se poursuit à l’intérieur
des journaux, certes de façon plus marquée
pour Libération (19 pour 17
pages consacrées à l’attentat),
mais Le Monde utilise plus de photographies
qu’à l’accoutumée
(11 pour 20 pages). Au-delà de l’extraordinaire
attraction visuelle produite par cet événement,
cette surreprésentation visuelle (à
laquelle nous pouvons rajouter les nombreux
schémas explicatifs des tours du World
Trade Center) semble aller plus loin. Face à
ces attaques, le récit parait insuffisant.
La lecture médiatique est dominée
par les images, dans une impression de stupeur
et de fascination. Cette profusion d’images
produit un véritable spectacle terroriste,
allant ainsi dans le sens voulu par les auteurs
de l’attentat, mais permettant également
une augmentation substantielle des ventes des
quotidiens.
Cette perception
se prolonge au sein des articles avec la présence
récurrente de témoignages de spectateurs
du drame. Saisis par la surprise, les journalistes
semblent, dans un premier temps, incapables
d’articuler un récit cohérent
et laissent la perception de l’événement
à d’autres acteurs. De nombreux
chapeaux (8) se contentent
ainsi de reprendre des citations de passants
(Libération, pp.4 et 5 du 12
septembre 2001 « Assise sur le
bitume, une New-Yorkaise sanglote : “On
ne peut rien faire, l’Amérique
va disparaître. Dieu, bénissez-nous.” »,
trois articles du Monde daté
du 13 septembre sont titrés à
l’aide de citations d’habitants
de Manhattan). Les registres sémantiques
utilisés se rapprochent de ceux décrivant
des catastrophes naturelles, notamment les tremblements
de terre (les images de bâtiments détruits
et effondrés viennent renforcer cette
impression). Ainsi, la une du 13 septembre 2001
de Libération montre trois pompiers
new-yorkais au milieu des ruines du World Trade
Center sous une “titraille-témoignage”
« On va fouiller encore et toujours ».
Dans la même logique, les deux journaux
catégorisent leurs articles sur les recherches
de victimes dans les décombres et la
situation à New York avec la même
expression « le jour d’après »
qui renvoie à cette idée de renaissance
après la fin du monde.
Emotion
et réprobation : la gestion classique
Toutefois,
dans le même temps, les journaux commencent
à énoncer le travail de deuil
dans une logique proche de la « souffrance
à distance » (9)
. Les récits médiatiques rencontrent
alors les discours politiques qui se concentrent
en priorité sur l’émotion
suscitée (Jacques Chirac parle « avec
une immense émotion »
de « cette épouvantable
tragédie », Lionel Jospin
exprime « une émotion
profonde » et « une
tristesse horrifiée »)
et une solidarité fortement affichée
avec les Etats-Unis, sa population et son gouvernement.
Ces réactions d’horreur et de stupeur,
pour authentiques et légitimes qu’elles
soient, viennent également s’inscrire
dans une logique de proximité des représentants
politiques. Cette affirmation d’une «
sensibilité », d’une humanité
censée rapprocher le politique du citoyen
renvoie à l’intrusion de l’intime
dans le discours politique. La question est
de savoir si cette « politique de la pitié
» ne masque pas une incapacité
politique à agir contre des problèmes
dont l’origine paraît irrationnelle
et manquant de sens (10).
Au sein de ces
discours apparaissent dans le même temps
les registres de réprobation, essentiellement
construits sur la dénonciation de l’utilisation
de la violence et de la barbarie des auteurs
de l’attentat (le Premier Ministre condamne
« ce recours abominable à la
violence terroriste », Jacques
Chirac dénonce ces « attentats
monstrueux – il n’y a pas d’autre
mot », le secrétaire
d’Etat aux Anciens Combattants estime
enfin que « ces actes effroyables
de terreur ne peuvent qu'inspirer horreur, colère
et indignation »). La dénonciation
de la barbarie des terroristes est un processus
traditionnel du discours anti-terroriste car
il permet de cliver l’espace politique
en deux camps indissociables. Ces discours sur
le 11 septembre nous permettent ainsi d’appréhender
la figure de l’ennemi et du Mal, rejetée
dans le camp de la barbarie et de recréer
une crédibilité à la puissance
publique, défenseur de la “civilisation”.
Si les réactions d’horreur et les
condamnations du terrorisme sont authentiques
et légitimes, elles n’entrent pas
moins dans une perspective de légitimation
de l’action et du système politique,
fragilisé par la rupture terroriste dans
son obligation fondamentale de sécurité
de ses citoyens.
Le choix
de la stratégie guerrière et les
premières réponses politiques
Ainsi,
les occurrences du passé, utilisées
pour caractériser les attentats, rencontrent
la nécessité de donner du sens
à l’événement en
le réinscrivant dans un système
culturel reconnu et maîtrisable. D’emblée,
les commentateurs ont repris à leur compte
la référence à l’attaque
japonaise contre Pearl Harbor pour catégoriser
la vague d’attentats qui a touché
le sol américain (11).
De la même manière, de nombreux
discours de solidarité envers les Etats-Unis
situaient l’origine de cette fraternité
dans la participation américaine aux
deux guerres mondiales en Europe (ainsi, le
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants
déclarait que « [les Etats-Unis]
avaient su répondre par deux fois au
cours du siècle précédent
à nos appels pour reconquérir
notre liberté. ») (12).
C’est dans l’usage du passé
que se noue une des premières connexions
entre récits politiques et médiatiques.
Elles se poursuivent dans la reprise médiatique
des actions gouvernementales.
Dans cette perspective,
les discours politiques et les récits
médiatiques se rejoignent, les journaux
embrayant rapidement sur la recherche des coupables
ou la réponse américaine (« Le
temps du deuil, le choix de la riposte »,
une du Monde du 14 septembre 2001,
« Les Etats-Unis sur la piste
des coupables , Libération,
13 septembre 2001, p. 2). Afin de mettre en
lumière le lien entre presse et pouvoirs
publics, nous pouvons, par exemple, noter que
la piste Ben Laden a été avancée
dès la journée de mardi par des
sources anonymes du gouvernement fédéral
américain et ensuite relayée par
tous les médias occidentaux. Dans un
second temps, les différents journaux
ont pu construire leurs récits sur les
groupes terroristes islamistes (description
de l’organisation Al-Qaida, biographie
de Oussama Ben Laden, éclairage sur le
régime taliban en Afghanistan, etc.).
Cette reprise de la parole des autorités
n’interdit pas en revanche de critiquer
les lacunes de ces mêmes autorités
en matière de renseignements (au moins
dans la presse française). Dans le cadre
des attentats du 11 septembre 2001, la stratégie
gouvernementale américaine a été
d’assimiler l’attaque terroriste
à un acte de guerre (ce que la propagande
jidahiste corroborera par ailleurs) dans une
perspective traditionnelle de la lutte contre
le terrorisme. « Les politiques
de prévention et de répression
du terrorisme, une fois mises en place ne peuvent
fonctionner qu’autour de deux schémas
qui, chacun à leur manière, occultent
la spécificité du terrorisme.
Dans le premier cas, on dissimule le terrorisme
en l’assimilant aux pratiques de droit
commun, (…) en terme de criminalité
individuelle. Dans le second cas, on l’assimile
à une nouvelle forme de guerre, on ne
lui donne que son caractère politique
pour pouvoir lui appliquer un raisonnement stratégique,
délimitant l’ennemi (…).
On simule l’affrontement guerrier. »
(13) . Cet angle de vue sera
largement relayé par les différents
journaux, nettement moins par les dirigeants
gouvernementaux français qui hésiteront
à utiliser le terme de “guerre”.
C’est ainsi que peut s’interpréter
la présence dans les articles d’un
vocabulaire de la guerre conventionnelle (« scènes
de guerre », « attaque »,
« timing de guerre »)
mais, également, les références
récurrentes à la Seconde Guerre
Mondiale (« Pearl Harbor terroriste »,
« L’effet Pearl Harbor »).
Face au mystère
et à l’inquiétude suscitée
par les attentats, les journaux construisent
un certain nombre de discours centrés
sur la peur ou la menace. Ce registre peut aussi
bien recouvrir les craintes d’une récession
économique (« Les craintes
d’une récession forcément
mondiale », Libération
du 13 septembre 2001, p. 22) que celles d’autres
formes d’attaques terroristes (« Le
spectre grandissant du terrorisme biologique »
ou « Inquiétude pour la
sécurité des centrales nucléaires
américaines »,
Le Monde daté du 14 septembre
2001, p. 11). Ces récits rencontrent
alors les inquiétudes exprimées
par les dirigeants politiques (le ministre de
la Défense, Alain Richard, évoque
la « vulnérabilité
des sociétés démocratiques
ouvertes » tandis que
Lionel Jospin estime que l’attentat est
la résultante de « tensions
qui viennent de forces obscures »).
Ce vocabulaire de la menace participe certes
d’une inquiétude réelle
jusque là peu perceptible mais comporte
aussi une part stratégique. La première
décision prise par les dirigeants français
a été de réactiver le plan
Vigipirate afin de montrer sa réactivité
et sa volonté de rassurer la population
au-delà d’un réel effet
dissuasif. Ici, perceptions de la menace et
tentative de résolution concrète
se rejoignent dans une même décision
politique. Ce discours menaçant et déstabilisant
concourt à une action pratique et lisible
du gouvernement afin d’ « exister
» politiquement, par exemple en renforçant
les mesures législatives sécuritaires
(14).
Au terme de cette étude succincte sur
la médiatisation des attentats du 11
septembre 2001, nous pouvons voir que les médias
ont été le lieu de la première
réponse au terrorisme. Les dirigeants
politiques ont tenté d’y faire
pénétrer, parfois avec succès,
leurs propres discours régulateurs mais
la plupart du temps, la proximité entre
les perceptions politiques et médiatiques
a été fortuit. L’attentat
ayant touché au plus profond des valeurs
communes, l’ensemble des acteurs s’est
ressoudé autour d’un même
consensus. Pour autant, en relayant les images
de désolation et en relevant ses propres
limites, les médias ont également
favorisé l’efficacité attendue
de l’attentat au point d’en faire
un événement historique fondamental
dans la marche de la planète.
-----------------------
1 - J.-L. Marret, « Terrorisme
: les stratégies de communication »,
étude du Centre d’étude
en sciences sociales de la défense, juillet
2003.
2 - Cette définition
provient de la loi anti-terroriste du 22 juillet
1986.
3 - P. Mannoni, «
Le terrorisme, un spectacle sanglant »
in « Violences », in Sciences
humaines, Hors-série n° 47,
décembre 2004-janvier-février
2005, p. 64.
4 - Bigo Didier et Hermant
Daniel (dir.), Approches polémologiques.
Conflits et violence politique dans le monde
au tournant des années 80, Paris,
Fondation pour les études de la Défense
Nationale, 1991, p. 430.
5 - M. Wieviorka et D.
Wolton, Terrorisme à la une. Media,
terrorisme et démocratie, Gallimard,
Paris, 1987, p. 210.
6 - I. Garcin-Marrou,
Terrorisme, Médias et Société,
PUL, Lyon, 2001, p. 126.
7 - Il faut également
ajouter la crainte d’une réaction
violente des Etats-Unis.
8 - Les petits paragraphes,
écrits en gras et différenciés
du reste de la page, se trouvant sous le titre
de l’article.
9 - L. Boltanski, La
souffrance à distance, Métailié,
Paris, 1993, 287 p.
10 - Pour le cas qui
nous occupe, nous pouvons mettre en balance
le soutien ostensible affiché par les
dirigeants français aux Américains
et la participation militaire réduite
à la campagne d’Afghanistan.
11 - Voir, par exemple,
Jacques Amalric, « L’effet Pearl
Harbor », Libération,
12 septembre 2001, p. 5 ou « L’Amérique
sous le choc d’un "Pearl Harbor"
terroriste », Le Monde, 13 septembre
2001, p. 2.
12 - « Réactions
du gouvernement aux attentats aux Etats-Unis
», site internet officiel du Premier Ministre,
13 septembre 2001 ou « Rennes se rappelle
de la dette de 1945 », Libération,
13 septembre 2001, p. 29.
13 - D. Bigo et D.
Hermant, « Simulation et dissimulation.
Les politiques de lutte contre le terrorisme
en France », in Sociologie du travail,
4-1986, pp. 506-526
14 - Cinq semaines
après le 11 septembre 2001, le ministre
de l’Intérieur, Daniel Vaillant,
présentait treize amendements au Sénat
dans le cadre de le seconde lecture de la loi
sur la sécurité quotidienne. Cette
adjonction élargissait les pouvoirs de
police en matière de fouille ou de surveillance
électronique.
|